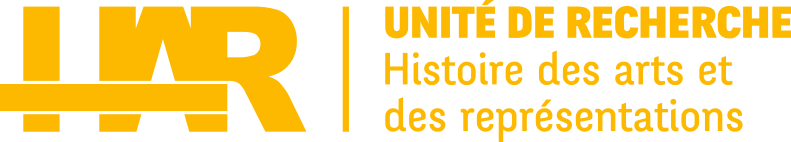Responsable(s)
Financeur(s)
Durée
Notre époque met souvent l’accent sur la dimension technologique des dispositifs immersifs, insistant tour à tour sur les notions d’interactivité, de réalité virtuelle, de perception augmentée — autant de promesses d’intensification de l’expérience muséale ou cinématographique. Mais le principe d’immersion est plus ancien que ces expressions contemporaines corrélées à un appareillage technologique plus ou moins sophistiqué. Certaines formes primordiales de scénarisation, de mise en scène et de dramatisation ont pu jouer très tôt un rôle immersif, augurant l’installation du sujet de la perception dans une attitude d’adhésion (appareillée ou non) qui peut aller jusqu’à la subjugation. Loin de cibler les technologies contemporaines de l’immersion, notre propos se focalise en premier lieu sur le sujet d’une condition immersive qui a débuté il y a bien longtemps — avec les explorations des tombeaux d’Égypte et autres déambulations souterraines où s’origine possiblement l’immersion.
Notre intuition, en second lieu, est qu’une archéologie de l’immersion, loin de se limiter à la réalité des dispositifs, devrait en passer par les fictions du cinéma. Fondamentalement, notre propos est d’interroger la contribution théorique (réflexive) du cinéma de fiction à l’invention de l’immersion comme expérience psychique et perceptive, à partir de certains récits exemplaires. À quel titre ? Pour leur capacité à mettre en scène et à figurer certains traits éventuellement constitutifs d’une condition immersive — susceptible de s’exprimer dans des dispositifs variables et d’affecter indifféremment l’homme du cinéma, le visiteur du musée, ou encore le video gamer.
Pour le dire autrement, l’enjeu est de scruter les imaginaires singuliers auxquels le cinéma a donné forme à un moment où l’immersion n’était pas encore désignée en tant que telle. Nous gageons en effet que le cinéma a rêvé et figuré l’immersion bien avant que celle-ci ne trouve sa pleine extension technologique dans l’espace muséal ou cinématographique.
Sur le plan de la méthode, enfin, l’archéologie esthétique ici mise en œuvre, si elle n’ignore pas ces grands prédécesseurs que constituent l’Archéologie des médias, d’une part, et d’autre part, l’Archéologie du savoir (M. Foucault), se distingue de l’une et l’autre entreprises.
Dans un premier temps, le séminaire doctoral HAR Cinéma 2022-2023 — co-dirigé par Barbara Le Maître (PR cinéma, UPN), Natacha Pernac (MCF histoire de l’art, UPN) et Jennifer Verraes (MCF cinéma, Paris 8), et incluant dix doctorants des universités Paris Nanterre, Paris 8 et Paris 3 — s’est attelé à la mise en œuvre de cette archéologie cinématographique de la condition immersive. Dans le cadre de ce séminaire, nous avons croisé d’autres archéologies des phénomènes immersifs impliquant des méthodologies et des corpus distincts des nôtres. En concertation avec les doctorants, nous avons décidé́ de transformer la dernière séance du séminaire doctoral en deux Journées d’étude (4 et 5 mai 2023) au cours desquelles cinq collègues européens impliqués dans diverses archéologies de l’immersion ont été invités à venir présenter leurs travaux et discuter de leurs objets et méthodes ; dans le même temps, plusieurs doctorants ont proposé une communication. Outre les échanges avec les collègues européens sollicités, ces Journées ont également permis d’enrichir notre réflexion via la rencontre avec des concepteurs d’environnements virtuels.
Depuis 2024, nous préparons un ouvrage issu des Journées d’études de 2023, augmenté de nouvelles contributions. Le travail éditorial — lecture, expertise, discussion de l’ensemble des textes — s’effectue en complète collaboration entre les titulaires et les doctorants.