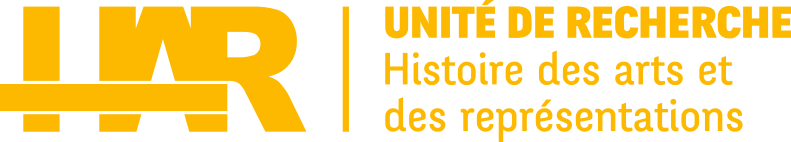Projet initié dans le cadre d’une délégation CNRS au Centre André Chastel – Sorbonne université (1er février-31 juillet 2025).
Depuis le cinéma dit primitif (Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants, G. Méliès, 1902) jusqu’au temps présent (Going my Home, H. Kore-eda, 2020), bien des films de fiction ont façonné et mis en scène des miniatures anthropomorphes, toutes miniatures, surtout, vivantes et mobiles, ce qui implique que le changement d’échelle puisse être modulé au gré du film. Le présent projet de recherche se voue à de tels motifs associés à un changement d’échelle, sans a priori de genre (mais le fantastique s’impose), d’auteur ou d’époque.
À l’envisager au-delà du seul manuscrit enluminé — c’est ici un impératif —, la miniature dessine un territoire aussi vaste qu’hétérogène, qui inclut le santon aussi bien que les versions réduites de la grande statuaire grecque ou romaine ; le bateau en allumettes logé dans sa bouteille de verre aussi bien que la figurine automate de la boîte à musique ; la population des dolls’ houses ou autres dioramas, etc.[1]. À cette liste, qui atteste une forme de disparate et fait lever l’image de la merveille, s’ajoutent d’autres types de figurines dont les enjeux excédent la question de l’art, notamment les miniatures en corne ou en ivoire façonnées par les Inuit — chez lesquels opère de surcroît « l’âme-tarniq », version miniaturisée du corps humain ou animal.
Emplie de curiosités et d’objets parfois sorciers, l’histoire de la miniature en passe, au XVIIIe, par le perfectionnement d’instruments tels que les microscopes ; de même qu’elle dépend, au XIXe, de la mise au point de techniques de reproduction à différentes échelles. À cet endroit, on peut noter l’invention (contemporaine de celle de la photographie) de la machine à réduire — dont parmi d’autres, The Devil-Doll (T. Browning, 1936), Dr Cyclops (E. B. Schœdsack, 1940), Attack of the Puppet People (B. I. Gordon, 1958) et Innerspace (J. Dante, 1987) réitèrent le principe en le transposant dans l’espace d’une fiction anthropologique : désormais, c’est le vivant qui rétrécit.
Considérée de manière ample, la miniature engage presque tous les arts et traverse presque toutes les époques. Curieusement, elle n’a pas été étudiée au cinéma : en particulier, les relations nouées avec l’histoire de l’art et l’anthropologie n’ont pas été examinées — cette dernière relation se justifiant du fait que le cinéma, en miniaturisant le vivant, donne vie à la miniature (vie d’image).
Le projet initié dans le cadre de cette délégation vise en somme à construire l’objet singulier qu’est la miniature (humaine) filmique à partir du cinéma de fiction, en sondant les imaginaires et les dispositifs — artistiques, anthropologiques et épistémologiques — dont elle est tributaire, ainsi que les discours qu’elle porte dans le champ d’une histoire des formes élargie.
Le caractère interdisciplinaire de ce projet combine nécessairement la méthodologie de l’analyse filmique avec des savoirs et des objets relatifs à l’histoire de l’art et à l’anthropologie. Afin de réfléchir aux modalités d’une telle « interdiscipline », une table-ronde réunissant chercheurs et doctorants en cinéma et histoire de l’art est organisée en collaboration avec Mme Valérie Mavridorakis et M. Guillaume Le Gall (professeurs en histoire de l’art contemporain à Sorbonne Université). Intitulée « Vices et vertus de l’interdisciplinarité : entre histoire de l’art et études cinématographiques », celle-ci est prévue le 22 mai 2025 au Centre André Chastel – INHA, salle Perrot, de 14h à 18h.
[1] La plupart de ces exemples sont évoqués dans Penser le « petit » de l’Antiquité au premier XXes. Approches textuelles et pratiques de la miniaturisation artistique, Sophie Duhem, Estelle Galbois, Anne Perrin Khelissa (dir.), Lyon, Ed. Fages, 2017.