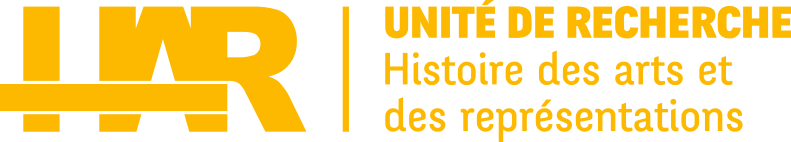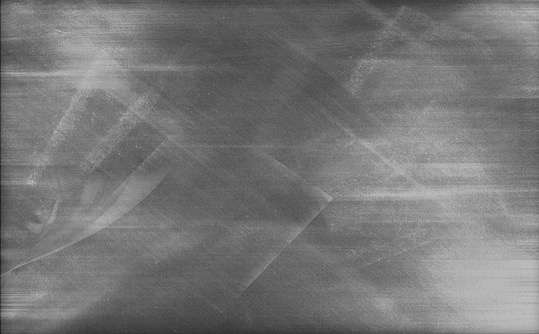Appel à communication
Colloque international « Cinéma, spoliations et restitutions »
Paris, 5-6-7 février 2026
Université Paris Nanterre
Comité d’organisation
- Théo Esparon, docteur en études cinématographiques, université Paris Nanterre, HAR,
- Ghislaine Glasson-Deschaumes, directrice de la MSH Mondes, Nanterre
- Barbara Le Maître, professeure en études cinématographiques, université Paris Nanterre, HAR
- Maureen Murphy, professeure en histoire de l’art contemporain, université Paris Nanterre, HAR
- Natacha Pernac, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, université Paris Nanterre, HAR
- Klaudia Podsiadlo, chercheuse de provenances, chargée du secteur géo-linguistique polonais, La Contemporaine
- Margaux Dumas, historienne, spécialiste des questions de spoliations et restitutions, EHESS/MSH Mondes
Membres (confirmés) du comité scientifique
- Théo Esparon, Barbara Le Maître, Maureen Murphy, Natacha Pernac, Klaudia Podsiadlo, Margaux Dumas
- Aurore Chaigneau, professeure de droit et sciences politiques, université Paris Nanterre
- Christophe Gauthier, professeur en histoire du cinéma, école des Chartes
- Monica Heintz, anthropologue, projet CINEMAF Images animées, mémoires controversées, LESC Nanterre
- Bénédicte Savoy, Professeur d’histoire de l’art, Technische Universität, Berlin
- Didier Schulmann, conservateur général du patrimoine honoraire, centre Georges Pompidou, ancien chef de service de la bibliothèque Kandinsky, Paris.
Dans la suite du colloque Musées au cinéma (2014) et de sa publication (dir. B. Le Maître, J. Jibokji, N. Pernac, J. Verraes, Presses universitaires de Nanterre, 2018) et dans la continuité des échanges scientifiques du Diplôme Universitaire «Recherche de provenances: circulations, spoliations, trafics illicites et restitutions», est apparue la nécessité d’investiguer un champ beaucoup moins connu des recherches de provenance, celui des spoliations du cinéma (1), mais aussi la représentation des spoliations -et des restitutions- au cinéma (2 et 3), tant dans la période 1933-1945 que dans les contextes coloniaux et post-coloniaux. Si les objets d’études sont artistiques, l’étude est fondamentalement pluridisciplinaire et requiert l’expertise croisée de chercheurs en histoire, histoire du cinéma et histoire de l’art, anthropologie, sciences politiques, droit, histoire des médias, travaillant sur des aires culturelles variées (Europe, Afrique, Russie, Asie…), auxquels s’ajoutent réalisateurs et documentaristes.
1. Le phénomène de la spoliation du cinéma, et plus particulièrement des films en tant que biens culturels (1933-1945), est méconnu et en voie d’exploration. Bien que des recherches aient été menées sur certains aspects, notamment sur la spoliation du cinéma français par les nazis (Leroy, 1999), la prise de guerre des films des services cinématographiques militaires (Launay, 2018), ou encore le sort des films-trophées saisis par les Soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale (Pozner, 2012), cette histoire est souvent qualifiée d’« histoire en chantier » (Cœuré, 2018). Il s’agit d’explorer un phénomène difficile à quantifier, tout en soulignant les difficultés théoriques et méthodologiques inhérentes à la nature fondamentalement reproductible de l’œuvre filmique. Si l’organisation des structures spoliatrices en France — Propaganda Abteilung versus ERR Rosenberg, en lien étroit notamment avec l’administration de Vichy (CGQJ, COIC) — est aujourd’hui mieux documentée (Podsiadlo, 2024), il n’existe pas encore d’étude de cette spoliation systématique à l’échelle européenne, complexifiée par les transferts successifs vers Berlin durant la guerre, puis vers Moscou à la fin du conflit. La spoliation des films, qu’ils aient été censurés, interdits ou réutilisés a été seulement partiellement étudiée, malgré son importance manifeste dans la propagande idéologique et dans les politiques culturelles du régime nazi, puis soviétique. Les objectifs exacts de ces saisies restent mal cernés. Vise-t-on la destruction, « l’épuration » de ce patrimoine, une instrumentalisation à des fins de propagande, un contrôle de la mémoire visuelle ? Quelles méthodes construire pour identifier les films et les réalisateurs spoliés ? Comment retracer ces prises opérées à l’échelle européenne et au delà ? Ce phénomène a-t-il eu des répercussions dans d’autres contextes historiques ? Les films peuvent-ils être parfois mobilisés comme preuves par l’image ? Ce premier axe de travail soulève des défis méthodologiques concernant la spoliation du cinéma en termes de traçabilité, de provenance, de détournement, mais aussi de restituabilité.
2. Le colloque souhaite s’intéresser à la représentation de la spoliation et des pillages de biens culturels au cinéma, aussi bien dans le contexte des grands conflits (Seconde Guerre mondiale…) que dans les cadres coloniaux et post-coloniaux. Le champ n’a pas fait l’objet d’étude dédiée en dépit de l’intérêt que signale Bénédicte Savoy (Savoy, 2018 et 2023). La multiplication des scenarii fictionnels sur le sujet des translocations patrimoniales forcées esquisse une typologie filmique spécifique ces dernières années, une sorte de déclinaison inversée de ce que fut la prolifération des tableaux de galeries de la dynastie des Francken dans les années 1600-1620 à Anvers. Comment la captation d’un héritage culturel, part sombre de l’histoire des guerres, a-t-elle été exposée par les réalisateurs ? Sous quels ressorts narratifs : enquête individuelle ou entreprise collective ? démarche scientifique ou quête intime ? Dans quels genres filmiques (films historiques, science-fiction, policiers, etc.) ? A partir de quelles sources et selon quelles formes de récit ? Comment sont mises en scène au cinéma les lacunes et les ellipses du parcours des objets ? Sur un plan plus directement esthétique, comment les films représentent-ils les objets associés aux translocations forcées ? Les œuvres sont-elles dégradées, voire ruinées ? Ou soustraites à la vue (et comment) ? Plus largement, comment les œuvres sont-elles transformées par la spoliation ? Quels sont les acteurs impliqués dans ces entreprises filmiques et avec quels moyens et quels objectifs opèrent-ils et pour quels publics ?
De fait, la production cinématographique a été (et est encore) utilisée comme un outil non seulement de reconstitution historique, de recontextualisation, mais aussi de démonstration, de propagande et d’exposition politiques, et de discussion, par un double biais, celui de la fiction et celui du documentaire. Dans le champ fictionnel, depuis le Train de Frankenheimer (1964), et jusqu’à la vague récente des films consacrés à de célèbres figures (Rose Valland et les Monuments Men, 2014), aux mouvements de revendications d’une justice historique (Les statues meurent aussi, 1953 ; Black Panther, 2018), le cinéma a pu mettre en scène quantité de spoliations comme de restitutions plus ou moins imaginaires avec ses propres moyens ; parallèlement aux débats publics, il les a tout autant illustrés qu’il les a lui-même nourris et orientés, usant de son attrait, de son efficience et de son pouvoir de conviction. Ce faisant, il offre un cadre de réflexion particulièrement stimulant pour repenser les écritures de l’histoire, la mise en forme des récits, le croisement des regards, et la construction des imaginaires ; il donne à réfléchir à la dimension collective et collaborative de la recomposition de ces parcours d’objet, étant lui-même par essence une production d’équipe, un art qui nourrit également la création contemporaine (voir par exemple l’installation cinématographique Once Again …Statues never dies ou Vagabondia d’Isaac Julian).
3. Dans le champ du documentaire sur les spoliations, les démarches pédagogiques et/ou scientifiques déployées conduisent à s’interroger sur le rôle des commanditaires et le poids des idéologies, sur la valeur du témoignage, les modalités de la quête et les objectifs de la collecte des traces. Pierre fondatrice, au croisement des démarches, le « film essai » de Resnais et Marker, Les statues meurent aussi (1953), commande à deux jeunes cinéastes devenue manifeste anticolonialiste, a posé la question de l’identité de l’art, de la spécificité de l’art africain (Senghor parlera en 1966, lors de l’inauguration du musée dynamique de Dakar, de la « visite solennelle de nos ancêtres et de nos dieux») : il interroge la place de celui-ci au musée, les phénomènes de muséalisation, d’ethnologisation, et d’artification, ainsi que des effets de la marchandisation (qui a fait de créations authentiques des productions touristiques sérielles).
L’étude de ces films, dont la vitalité actuelle est évidente (Murphy 2023), peut permettre d’amorcer une autre histoire et épistémologie de l’activité de la recherche de provenances, tout en éclairant le poids de la mémoire et du souvenir, mais aussi le processus cathartique, réparateur que la collecte d’archives et de preuves peuvent entamer. Une analyse croisée permettra de mieux comprendre la construction des discours et conjointement le rôle ou la place des institutions dans ou face à ces prises de parole, mais aussi permettra de mieux appréhender la dimension politique, engagée, individuelle, communautaire, nationale ou transnationale de ces productions, et les tensions géopolitiques auxquelles elles sont soumises ou liées. Elle sera d’autant plus riche que le corpus est large (outre la question des films d’artistes qui s’emparent de la question des spoliations) : cinéma européen, soviétique, grec, Bollywood, Nollywood (Nigéria), Hollywood, etc. Ces documentaires dont la motivation idéologique est affirmée, parfois jusqu’à constituer l’outil médiatique d’un activisme revendiqué (voir le docu-fiction Promakhos, sorti en 2014 pour l’anniversaire de la mort de Mélina Mercouri, chantre du retour des marbres du Parthénon), incorporent souvent une perspective historique qu’ils combinent de plus en plus avec une évocation sur l’horizon d’attente et les effets de la restitution : à cet égard, le film de Mati Diop en 2023, dirigeant son regard sur la réception, constitue un tournant. Quel rôle le cinéma est-il appelé à jouer conséquemment ? À ces titres, le cinéma constitue aujourd’hui l’un des acteurs fondamentaux des débats sur les translocations et les rapatriations de biens culturels, il assimile et livre à la fois une matière idoine pour la création et une réflexion sur la nature de l’héritage patrimonial en lien avec les problématiques sociétales et internationales actuelles les plus vives : « A qui appartient la Beauté ? l’œuvre d’art ? » demande Bénédicte Savoy, reprenant la discussion du Burt Lancaster dans Le Train de Frankenheimer. Le cinéma est au cœur brûlant de la présence des passés dans le présent, et de la projection de l’esprit des peuples dans l’avenir.
4. Le colloque pose en outre une série de problématiques qui touchent au droit. La complexité juridique de la propriété des films, avec ses dimensions matérielles, morales et intellectuelles, et la multiplicité des acteurs impliqués (producteur, réalisateur, exploitant) impactent la nature et les modalités de la spoliation du cinéma, qui peut être celles des réalisateurs, des œuvres, comme celle des studios, du matériel ou des salles. Il est nécessaire d’éclairer statuts juridiques changeants des films transloqués et les restitutions des films, tout comme la question des partages entre fonds (fonds d’archives cinématographiques partagés entre musées, ou dans les cinémathèques) ou celle des fonds filmiques relevant des archives de fouilles archéologiques.
Axes de réflexion (non exhaustifs)
- remploi et appropriation d’archives filmiques par les Nazis à des visées de propagande
- (re)définition ou exploration théorique de la spoliation à partir des spécificités des œuvres filmiques
- fictions de spoliation et/ou de restitution
- translocation et imaginaires patrimoniaux
- métamorphoses de l’œuvre spoliée
Organisation
Le colloque international interdisciplinaire se tiendra à Paris (Institut national d’Histoire de l’art, Université Paris Nanterre) les 5-6-7 février 2026. Il sera accompagné d’une programmation cinéma liée, avec présentations des projections et tables-rondes en présence de réalisateurs internationaux.
Les propositions de communication (comprenant un résumé de l’intervention en 300 mots maximum et une présentation biographique de l’orateur (5-10 lignes maxi) sont à envoyer à cine.spoliation@gmail.com d’ici au 20 octobre 2025. Le comité scientifique adressera aux orateurs potentiels une réponse sur leur participation début novembre 2025. L’organisation prendra en charge une partie des frais de participation (transport ou logement) pour les orateurs dont le rattachement institutionnel n’implique pas de soutien financier.